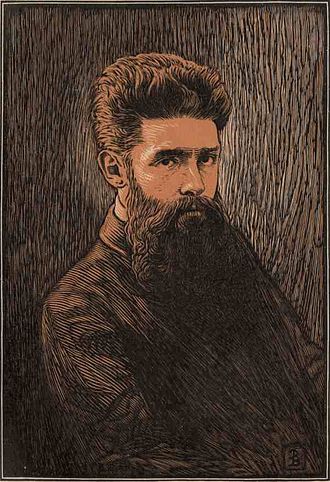Devant le ciel de nacre et d’or
Devant le ciel de nacre et d’or d’un soir d’été
Nous accoudons, pensifs, après la volupté,
Notre langueur d’amants heureux à la fenêtre.
Bientôt, comme un joyau candide, va paraître
A l’occident la belle étoile de l’amour
Qui fiance en tremblant la nuit avec le jour.
Sous mes doigts la fraîcheur de ta gorge palpite,
Je sens contre mon cœur ton cœur battre plus vite
Je pleurais, tu souris, et les instants sont longs.
Attentifs à nous seuls ainsi, nous contemplons
L’azur que la lumière hésite à quitter toute ;
Notre âme sans sortir de son silence écoute
Les fanfares de cors se répandre en éclats,
Puis feindre en expirant aux perrons des villas
L’écho dans la forêt d’une chasse lointaine
Et la rue, à nos pieds de crépuscule pleine,
Mêle au dernier refrain des trompes qui se tait
Le bruit des brocs faisant déborder la fontaine.
Au balcon où mon cacheur près du tien en secret
Goûte à ne plus aimer un délice muet,
La nuit fond nos deux corps en un groupe immobile.
Silence, ô mon amie entends et vois La ville
Assoupit sa profonde et confuse rumeur,
Et, d’étoile en étoile agitant ses fumées,
Semble offrir son Dieu l’encens de son labeur.
La paisible clarté des lampes allumées
Parfois découpe une ombre aux vitres des maisons.
Longtemps, et puis longtemps encore, nous nous taisons.
La tiède brise errante à l’haleine embaumée
Boit dans un grand baiser nos pleurs, ô bien-aimée !
Et nous tournons alors nos regards vers les cieux,
Car la prière est douce aux vrais voluptueux.
Tout à l’heure, au moment des étreintes farouches
Où les jeunes amants embrassés font entre eux
Comme la souple vigne et l’orme vigoureux,
Des roses, sous le souffle aride de nos bouches,
Tombèrent d’un bouquet voisin dans notre lit.
Tu palpitas; le creux de tes seins s’en remplit,
Et, parmi cette chute exquise de pétales
Qui veloutaient le jeu de nos forces brutales
Et, collés à tes dents ou pris dans tes cheveux
Ou doublant de satin les voiles de tes yeux,
Te couvraient d’une vague et multiple caresse,
Tu crias de plaisir en haletant, maîtresse.
Or voici que, fraîcheur soudaine, un coup de vent
Se coule entre nos doigts unis, et soulevant
Les pétales broyés par nos corps les disperse
A travers la croisée en odorante averse.
Leur vol tournoie et tombe avec lenteur, laissant
Une feuille peut-être aux lèvres d’un passant
Qui frémira, le cœur fondu, la chair troublée
Par le parfum d’amour qu’a cette chose ailée.
Vierge ou veuve, jeune homme inquiet ou vieillard,
Toi qui marches, traînant dans la rue au hasard
La langueur que nourrit une âme solitaire,
Ô Passant qu’une soif inconnaissable altère,
Ivre d’avoir mâche ce pétale de fleur,
Tu t’en iras pleurer de rage et de douleur
Dans les pauvres chemins déserts de la banlieue
Où le soir indécis suspend son ombre bleue.
Et nous, ma tendre amie, enlacés et songeurs,
Pour cacher à nos yeux notre âme éprise ailleurs
D’un rêve qui se dresse entre nos destinées,
Nous mêlerons encore nos têtes inclinées
Sous le sombre manteau de tes cheveux épars ;
Et, sentant venir l’heure amère des départs,
Nous nous plaindrons d’aimer et d’être heureux et d’être
Bouche à bouche, ramiers frileux, à la fenêtre,
Alors que la douceur de cette fin de jour
Torture obscurément les âmes sans amour.