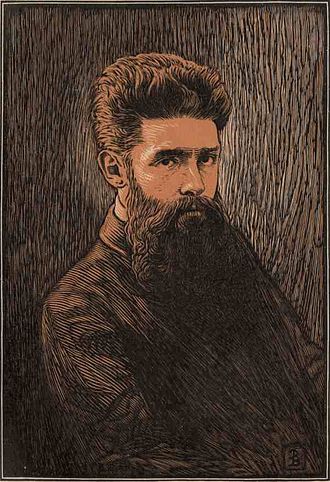Nuit d’ombre, nuit tragique, ô nuit désespérée
Nuit d’ombre, nuit tragique, ô nuit désespérée !
J’étouffe dans la chambre où mon âme est murée,
Où je marche, depuis des heures, âprement,
Sans pouvoir assourdir ni tromper mon tourment,
Et j’ouvre au large clair de lune la fenêtre.
Là-bas, et ne laissant que son faîte paraître,
Comme une symphonie où court un dessin pur
La montagne voilée ondule sur l’azur,
Et lie à l’orient les étoiles entre elles.
De légers souffles d’air m’éventent de leurs ailes.
Une rumeur qui gronde au revers d’un coteau
Dénonce la présence invisible de l’eau.
Baissant pour mieux rêver les paupières, j’écoute
Les sombres chiens de garde aboyer sur la route
Où sonnent les sabots d’un rôdeur attardé.
Alors, sur le granit dur et froid accoudé,
Douloureux jusqu’au vif de l’être et solitaire,
Je maudis la nuit bleue où le ciel et la terre
Sont comme un jeune couple à se parler tout bas ;
Et voyant que la vie, à qui n’importe pas
Un cœur infiniment désert de ce qu’il aime,
S’absorbe dans sa joie et s’adore soi-même,
Je résigne l’orgueil par où je restais fort.
Et j’appelle en pleurant et l’amour et la mort.
« C’est donc toi, mon désir, ma vierge, ô bien-aimée !
Faible comme une lampe à demi consumée
Et contenant ton sein gonflé de volupté.
Tu viens enfin remplir ta place à mon côté.
Tu laisses défaillir ton front sur mon épaule,
Tu cèdes sous ma main comme un rameau de saule,
Ton silence m’enivre et tes yeux sont si beaux,
Si tendres, que mon cœur se répand en sanglots.
Toi vers qui je criais du fond de ma détresse,
Sœur, fiancée, amie, ange, épouse, maîtresse,
C’est toi-même, c’est toi qui songes dans mes bras !
Te voici pour toujours mienne, tu dormiras
Mêlée à moi, fondue en moi, pensive, heureuse,
Et prodigue sans fin de ton âme amoureuse !
Dieu juste, soyez béni par cet enfant
Qui voit et contre lui tient son rêve vivant !
Mais toi, parle, ou plutôt, sois muette, demeure
Jusqu’à ce qu’infidèle au ciel plus pâle, meure
Au levant la dernière étoile de la nuit.
Déjà l’eau du malin pèse à l’herbe qui luit.
Et modelant d’un doigt magique toutes choses.
L’aube vide en riant son tablier de roses.
L’enclume sonne au loin l’angélus du travail.
Écoute passer, cloche à cloche, le bétail
Et rauquement mugir la trompe qui le guide !
La vallée a des tons d’émeraude liquide,
Et dans le bourg qui brille au milieu des prés verts,
Les fenêtres qu’on ouvre échangent des éclairs.
La fraîcheur de la vie entre par la croisée ;
Je l’aspire, j’en bois sur tes cils la rosée.
Et, mêlée à la grâce heureuse du décor,
Mon immortelle amour, tu m’es plus chère encore.
Nous tremblons, enivrés du vin de notre joie,
Et, dans le long délice où notre chair se noie,
Songeant que, pour bénir nos noces, le Destin
A revêtu la chape ardente du matin
Et qu’il emprunte au ciel son ostensoir de flammes.
Et voici qu’unissant leurs rêves, nos deux âmes,
A travers la rumeur grandissante du jour,
Pleurent dans l’infini silence de l’amour. »
L’amour ?… Lève les yeux, mon pauvre enfant, regarde !
Le val est toujours bleu de lune, le jour tarde,
La rivière murmure au loin avec le vent.
Et te voilà plus seul encore qu’auparavant.
La bien-aimée au front pensif n’est pas venue.
Le sein que tu pressais n’est qu’une pierre nue,
La voix qui ravissait tes sens n’est que l’écho
Du bruit des peupliers tremblants au bord de l’eau :
Hélas ! la volupté de cette heure attendrie
Fut le jeu d’un désir expert en tromperie.
Va, ferme la croisée, et quitte ton espoir.
Mesure en t’y penchant ton morne foyer noir :
N’est-ce pas toi cet âtre éteint où deux Chimères
Brillent d’un vain éclat sur les cendres amères ?
Et, puisque tout est faux, puisque même ton art
Aux rides de ton cœur s’écaille comme un fard,
Cherche contre l’assaut de ta peine insensée
L’asile sûr où l’homme échappe à sa pensée,
Ouvre ton lit désert comme un sépulcre, et dors
Du sommeil des vaincus et du sommeil des morts.