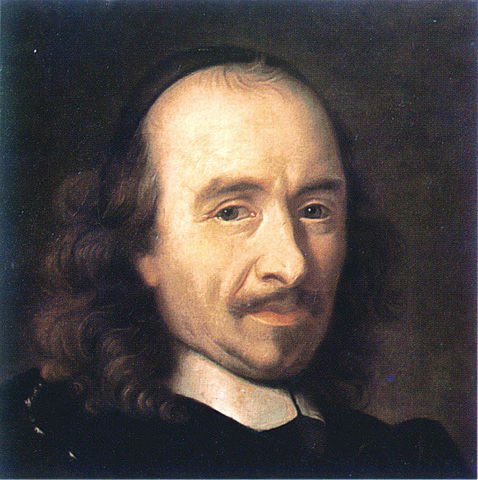Dans la grange…
À André Gide.
Dans la grange, sur le sol dur, bossué, battu,
le char dormait avec des rameaux de chêne cassés
dans les joints de son bois boueux et fendu.
La batteuse au ronflement qui s’enfle avait cessé
de tourner au milieu des bœufs patients,
et des tas de débris minces jonchaient la terre.
Les poules du Bon Dieu qui sont les hirondelles,
et qui avaient leur nid sur la poutre, tombèrent.
Alors deux métayers, lents et adroits, sautèrent
sur d’autres et, avec des clous, fixèrent
au plafond un morceau de fer-blanc retroussé.
Ils l’emplirent de paille et y mirent les petits tombés.
Alors on vit la mère des petits oiseaux
glisser craintivement dans l’azur, en réseaux
allongés.
Peu à peu, elle arriva au nid.
Je m’étais assis près des herses et du soc qui luit,
et j’avais dans le cœur une tristesse tendre
comme si j’avais eu dans le fond de mon âme
un rayon de soleil où vole un peu de cendre.
Vinrent huit petits cochons extrêmement si jolis
qu’on eût pu les offrir à de petites filles.
Ils n’avaient pas plus de trois semaines,
ils luttaient entre eux, arc-boutés comme des chèvres,
et leurs très petits pas étaient précipités.
La truie aux mamelles flasques et ridées,
aux soies rudes, groinait vers le sol, embouée.
La vie pauvre, par ce beau jour d’été,
m’a paru revêtir toute sa dignité.
Et lorsque sont passés, près de mon escabeau,
les paysans tristes, silencieux et beaux,
faisant rouler les roues dans l’ombre noire et fraîche ;
je ne leur ai rien dit et j’ai baissé la tête.
1897.